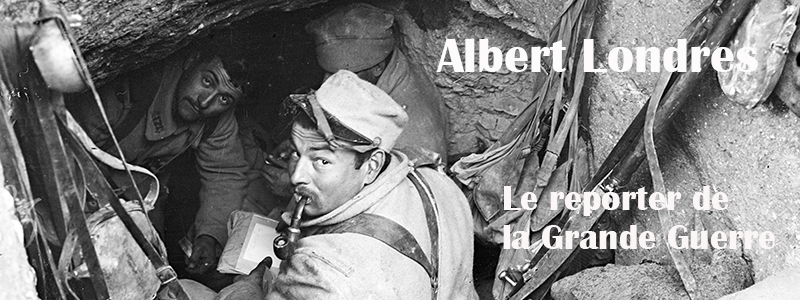Le Feu d’Henri Barbusse :
la Grande Guerre dans toute son horreur
Publié en 1916, Le Feu d’Henri Barbusse constitue l’une des premières œuvres littéraires sur la Première Guerre mondiale. À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de son auteur, ImagesDéfense vous propose de redécouvrir ce roman puissant, à mi-chemin entre fiction et témoignage, avec en contrepoint des images prises durant le conflit.
Barbusse, un jeune écrivain prometteur
Henri Barbusse est attiré par la littérature dès l’adolescence. Étudiant au collège Rollin à Paris, il a pour professeurs le poète Stéphane Mallarmé et le philosophe Henri Bergson. Il se fait remarquer dès 1892, alors qu’il n’a pas encore vingt ans, en participant à un concours de poésie organisé par le journal L'Écho de Paris. Cette expérience lui permet de rencontrer les écrivains Catulle Mendès et Marcel Schwob, qui lui ouvrent les portes des cercles symbolistes. Le jeune Henri occupe différentes fonctions dans l’édition et se fait peu à peu une place dans le monde littéraire parisien.
Il publie Pleureuses, son premier recueil de poèmes, en 1895, avant de se lancer dans le roman avec Les Suppliants (1903) puis L’Enfer (1908). Ce dernier met en scène un homme qui espionne ses voisins depuis sa chambre d’hôtel en regardant à travers la fente du mur qui sépare leurs logements. Cette intrigue voyeuriste ne manque pas de faire polémique, tout en assurant à Barbusse une certaine renommée dans le milieu littéraire.
Il écrit également des nouvelles pour le journal Le Matin, réunies en 1914 dans le recueil intitulé Nous autres. La première nouvelle de l’ouvrage, La Petite Lune méchante, se déroule durant les guerres balkaniques de 1912-1913, dans une plaine vaseuse trouée par les éclats d’obus. La nouvelle met en scène un accrochage accidentel entre deux patrouilles de l’armée macédonienne. Le texte se termine sur un constat amer et prémonitoire du conflit qui se prépare : « […] ils s’étaient tués, au hasard, à l’aveugle, à tâtons, sans se reconnaître, sans savoir qu’ils s’aimaient, sans comprendre qu’ils étaient frères, comme il arrive toujours dans la guerre… ».
Un engagé volontaire… antimilitariste
La déclaration de guerre de l'Allemagne le 3 août 1914 vient bouleverser toute la société française. La mobilisation générale est décrétée le 1er août pour tous les hommes âgés de vingt à quarante-huit ans. Âgé de quarante-et-un ans, Henri Barbusse n’est pas mobilisé, probablement pour des raisons de santé, l’écrivain souffrant de problèmes pulmonaires. Il aurait pu profiter de sa situation privilégiée et poursuivre tranquillement ses activités littéraires à l’arrière. Mais il décide de s’engager dans l’armée comme volontaire, et ce malgré ses positions antimilitaristes. Il ne se contente d’ailleurs pas de servir dans une troupe de réserve. Souhaitant prendre part aux combats, il rejoint l’infanterie.
Parti au front en décembre 1914, il participe de janvier à mai 1915 aux combats de Crouy, près de Soissons, puis s’illustre dans l’Artois de mai à novembre 1915. Son engagement lui vaudra deux citations et l’attribution de la Croix de guerre. Blessé à deux reprises et atteint de dysenterie, il doit faire plusieurs séjours dans des lieux de convalescence. Il est affecté dans des bureaux de l’arrière avant d’être finalement réformé en juin 1917.
C’est lorsqu’on l’éloigne du champ de bataille dans la deuxième moitié de l’année 1915 qu’Henri Barbusse commence à réfléchir à l’écriture d’un livre pour partager son expérience de soldat. Il consigne alors tout ce qui peut nourrir son ouvrage. « Je grappille tout ce que je peux sur mon travail de secrétaire pour mon travail de romancier », indique-t-il dans une lettre adressée à sa femme. L’auteur, qui veut que son œuvre soit la plus authentique possible, doit choisir la forme qu’elle prendra. « Mon livre sur la guerre n’est pas nouveau, oh non ! Il s’agit de décrire une escouade de soldats à travers les diverses phases et péripéties de la campagne. Ce n’est pas trop commode à mettre au point. » Comme l’indiquera son sous-titre Journal d’une escouade, Barbusse décide finalement d’adopter la forme du journal. Écrit à la première personne et au présent, le texte s’apparente à un témoignage, ce qui lui confère une force particulière.
Barbusse rédige le roman sur une période de six mois environ. Il paraît sous forme de feuilleton au fur et à mesure de l’écriture dans L’Œuvre, un journal contestataire proche de la gauche radicale, à partir du 3 août 1916. Le texte subit diverses suppressions et modifications lors de sa publication, au grand dam de Barbusse. Selon ce dernier, le directeur du journal, Gustave Téry, serait le principal responsable de ces coupes, et non les censeurs, qui n’ont pourtant pas la réputation d’être cléments. « Ils sont embêtants, embêtants, embêtants avec leurs suppressions continuelles qui diminuent et affaiblissent le texte à chaque instant. Que le diable les fume ! », s’agace-t-il dans sa correspondance. Pour préserver son texte, Barbusse décide de le publier en intégralité sous la forme d’un livre. Le Feu paraît chez Flammarion dans une version non censurée le 15 novembre 1916.
|
|
Un récit puissant entre roman et témoignage
À la frontière entre témoignage et fiction, Le Feu est reçu de manière très variable selon les différents lectorats. Le livre est bien accueilli par les soldats, dont l’expérience n’avait jusque-là jamais été racontée avec autant de force. « Camarades, dont j’ai partagé la vie et les pensées […], vous avez aimé mon livre parce que c’est un livre de vérité. Vous y avez reconnu votre misère et votre souffrance, vous y avez reconnu la grande guerre telle que vous l’avez faite », déclare Barbusse après la parution de l’ouvrage. Il reçoit également un bon accueil de la part des femmes de l’arrière qui, grâce à lui, découvrent pour la première fois la dure réalité que vivent leurs maris, fils, pères et oncles partis combattre.
Mais Le Feu est loin de faire l’unanimité pour autant. Certains lecteurs ne daignent lui accorder plus que le statut de simple témoignage, ne lui reconnaissant aucune qualité littéraire – sont mis en cause les marques d’oralité, le vocabulaire familier et les jurons qui émaillent le texte. D’autres, à l’inverse, lui reprochent son aspect fictionnel, l’accusant de travestir la réalité du front. Certaines critiques portent sur l’idéologie véhiculée : accusé d’être défaitiste voire pacifiste, Le Feu serait un agent de démoralisation pour les soldats. Le roman provoque même la colère de certains représentants de l’armée française.
Si Le Feu ne laisse aucun lecteur indifférent, c’est avant tout à cause de son réalisme sans concession. Aucun texte avant celui-ci n’avait en effet dépeint avec une telle force et authenticité la Grande Guerre. Barbusse ne se contente pas de donner à entendre la parole des poilus, il dépeint leur expérience du front dans toute sa violence, son angoisse, son horreur et sa crudité. Parmi les nombreuses descriptions, celles du champ de bataille jonché de cadavres sont particulièrement saisissantes :
« À côté de têtes noires et cireuses de momies égyptiennes, grumeleuses de larves et de débris d’insectes, où des blancheurs de dents pointent dans des creux ; à côté de pauvres moignons assombris qui pullulent là, comme un champ de racines dénudées, on découvre des crânes nettoyés, jaunes, coiffés de chéchias de drap rouge dont la housse grise s’effrite comme du papyrus. Des fémurs sortent d’amas de loques agglutinées par de la boue rougeâtre, ou bien, d’un trou d’étoffes effilochées et enduites d’une sorte de goudron, émerge un fragment de colonne vertébrale. Des côtes parsèment le sol comme de vieilles cages cassées, et, auprès, surnagent des cuirs mâchurés, des quarts et des gamelles transpercés et aplatis. Autour d’un sac haché, posé sur des ossements et sur une touffe de morceaux de drap et d’équipements, des points blancs sont régulièrement semés : en se baissant, on voit que ce sont les phalanges de ce qui, là, fut un cadavre. »
Une importante postérité littéraire
Les polémiques n’empêchent pas Le Feu de remporter le prix Goncourt en décembre 1916, un mois après sa parution. L’ouvrage connaît un important succès en librairie : 200 000 exemplaires sont vendus entre sa parution en 1916 et 1918. En 1934, les ventes atteignent un total de 350 000 livres écoulés, preuve que l’engouement des premières années, durant lesquelles l’ouvrage bénéficia sans aucun doute du contexte de la guerre, n’était pas qu’un simple phénomène de mode.
Le Feu constitue l’un des tout premiers témoignages littéraires sur la Première Guerre mondiale et reste, aujourd’hui encore, l’un des plus célèbres. Il marqua les esprits et fut suivi par des ouvrages aussi variés que Les Croix de bois de Roland Dorgelès (1919), Orages d’acier d’Ernst Jünger (1920), Ceux de 14 de Maurice Genevoix (recueil de récits rédigés entre 1916 et 1921 mais publié en 1949), À l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque (1929) ou encore Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline (1932).
Maxime Grandgeorge
Pour aller plus loin
Si vous êtes férus de littérature, découvrez d'autres focus du même type :
- Albert Londres, reporter de la Grande Guerre
- Le Silence de la mer de Vercors : chronique de l’Occupation
Découvrez également dans notre boutique de nombreux produits sur les poilus et la Première Guerre mondiale :
- le DVD Le film du poilu ;
- le livre Avènement d'une culture visuelle de guerre - Le cinéma en France de 1914 à 1928 ;
- le livre La Grande Guerre en couleurs ;
- le livre Derrière les images - Photographier la guerre.

![Reims. Deux poilus place Royale. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/2/1273392_3_1.jpg)
![Argonne, Est (Marne). Secteur du Four-de-Paris. Le repas des hommes dans la tranchée. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/9/9/996190_2_1.jpg)
![Réduit d'Avocourt (Meuse), soldats au repos dans une tranchée de soutien. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/9/9/990045_2_1.jpg)
![Région de la ferme des Marquises (Marne). Dans le boyau de la Courtine. L'heure de la soupe. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5127797_8_1.jpg)
![[Soldats aux aguets.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970042_4_1.jpg)
![[Soldats aux aguets.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970046_4_1.jpg)
![[Soldats aux aguets.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970049_4_1.jpg)
![[Soldats aux aguets.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970052_4_1.jpg)
![[Soldats se mettant à l'abri dans un village.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970055_4_1.jpg)
![Plus peur du garde que du boche... [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970061_4_1.jpg)
![La relève. Pas-de-Calais, 1915. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970064_4_1.jpg)
![Cadavres allemands. Pas-de-Calais, 1915. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970416_4_1.jpg)
![[Champ de bataille enneigé.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/9/5970297_4_1.jpg)
![Région de la ferme des Marquises (poste ouest). Travailleurs creusant un abri en mine. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5127468_10_1.jpg)
![Au bois des Satyres près d'Estrées, soldat faisant la correspondance. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/7/1/71132_11_1.jpg)
![Bois des Buttes, entrée d'une sape allemande utilisée par les Français. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/6/5/6596679_6_1.jpg)
![Près d'Oeilly (Marne). Cadavre allemand. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5121116_10_1.jpg)
![Près de la ferme Moufflaye (au dessus de Vic-sur-Aisne). Pose de fils barbelés sur un boyau donnant accès aux 1res lignes. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/6/1695735_8_1.jpg)
![Région de la Fontaine Houyette, Marne, sortie d'un abri pour mitrailleuse, abri Ponceau. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/6/6/6652381_2_1.jpg)
![Souchez, Pas-de-Calais, soldats au bas des pentes de Notre-Dame-de-Lorette, regardant passer la mission japonaise. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/7/1701407_12_1.jpg)
![Ancienne tranchée allemande près d'Estrées dans le bois des Satyres. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/7/1/71091_11_1.jpg)
![Région de la Main de Massiges, Marne, tranchée de première ligne (ancien boyau allemand Eitel). [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5125563_9_1.jpg)
![Meuse. Trottoir américain. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5124293_10_1.jpg)
![Secteur de la ferme de Navarin, Marne, abri en mine dans une tranchée de première ligne. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5125395_9_1.jpg)
![Secteur de Bannholz, bois carré - entrée de sape. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/7/2/72169_7_1.jpg)
![Cadavre d'un soldat évacué du champ de bataille. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/6/7/67779_8_1.jpg)
![La musette, cadavre allemand dans une tranchée. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/6/7/6731020_1_1.jpg)
![Cote 304, cadavre dans la tranchée. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/2/5/2583529_7_1.jpg)
![Nancy, découverte d'un corps dans les décombres d'un immeuble. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/7/3/73873_7_1.jpg)
![Tranchée allemande du Talou, poilus cassant la croûte. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5137441_10_1.jpg)
![Le Balcon, cadavres. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/9/1901018_7_1.jpg)
![Maurepas dans la Somme. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/2/5/2583155_5_1.jpg)
![Courcelles-Epayelles, cadavre allemand resté entre les lignes depuis le 15 juin, date de notre contre-attaque. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/7/7/77611_4_1.jpg)
![Marest-sur-Matz, trous individuels au bord du "chemin creux". [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/7/7/77190_9_1.jpg)
![Région des Grandes Dunes, guetteurs pourvu de socques de tranchée. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/5/1/5130702_5_1.jpg)
![Soldats dans une tranchée. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/4/1418538_18_1.jpg)
![Crouy (Aisne). Au poste de secours. Blessés français et allemands. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/7/1705703_5_1.jpg)
![Crouy (Aisne). Le poste de secours. Blessés français et allemand. [légende d'origine]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/1/7/1705669_5_1.jpg)
![[Région du Mont sans nom (Marne). Cérémonie funéraire d'un soldat tombé au front.]](https://imagesdefense.gouv.fr/media/catalog/product/cache/15c2d697f4361d5a5843ebce5d137147/3/5/3543928_2_1.jpg)